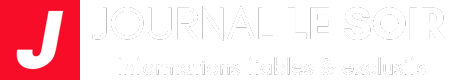[ad_1]
Les Pénétrantes Autoroutières en Algérie : Un Bilan Préoccupant Dix Ans Après
Il est désormais évident que les sept projets majeurs de pénétrantes autoroutières lancés en Algérie il y a dix ans sont confrontés à un bilan plus que préoccupant. Alors que le pays aurait dû bénéficier d’une infrastructure moderne et efficace pour relier ses différentes régions, les retards accumulés et les problèmes techniques ont créé un véritable malaise économique et social dans les zones concernées.
Le cas de la pénétrante de Jijel est particulièrement révélateur des défaillances constatées. Lancé en 2014 avec des promesses d’achèvement en trois ans, ce projet de 110 kilomètres n’est toujours pas terminé après une décennie de travaux. Les récentes décisions visant à redistribuer certains tronçons à de nouvelles entreprises ne font que confirmer les erreurs d’appréciation initiales. L’objectif actuel, fixé à 2026, implique un retard de neuf ans, ce qui a des conséquences directes sur l’activité du port de Jijel, privé d’une connexion efficace avec l’arrière-pays.
La situation n’est guère plus détendue concernant la pénétrante de Béjaïa, même si elle affiche un taux d’avancement plus satisfaisant avec 84 kilomètres réalisés. Les 16 kilomètres restants, pourtant cruciaux pour la liaison avec le port, restent en suspens en raison de retards inexpliqués. La redistribution des travaux à de nouvelles entreprises souligne les limites du système d’attribution initial et met en lumière la défaillance des mécanismes de contrôle. Les opérateurs économiques de la région estiment les pertes liées à ces retards à plusieurs millions de dinars par mois, un véritable saignement pour l’économie locale.
La pénétrante Tizi Ouzou-Bouira offre peut-être l’exemple le plus préoccupant de l’échec de ces projets. Malgré la complexité du relief, qui est régulièrement invoquée pour justifier les retards, il est évident que les insuffisances dans la préparation technique du projet sont en grande partie responsables de la situation actuelle. La réorganisation des contrats intervient bien tardivement pour un chantier qui aurait dû prendre en compte ces contraintes dès sa conception. Cette situation pénalise particulièrement le développement économique de la Kabylie, région à fort potentiel touristique et industriel, mais qui se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de valoriser ses atouts en raison de l’absence d’infrastructures routières adéquates.
Face à l’ampleur des retards, les mesures déployées par le ministère des Travaux publics visent à endiguer les défaillances initiales, mais elles révèlent également l’étendue des défaillances du système. L’établissement d’avenants aux contrats et l’intervention de nouvelles entreprises soulèvent quant à elles des questions sur le choix initial des prestataires et leur capacité à mener à bien des projets d’une telle envergure. Le renforcement tardif du suivi technique et financier, ainsi que l’instauration d’un système de contrôle mensuel, ne font que souligner l’absence préoccupante de ces mécanismes fondamentaux durant des années.
L’implication d’entreprises nationales “ayant fait leurs preuves” intervient comme un correctif de dernière minute, mais elle remet en question la pertinence des critères de sélection initiaux. Le plafonnement des augmentations budgétaires à 10% du montant initial des marchés apparaît comme une tentative de limiter les dégâts financiers, mais sans garantie que ce cadre strict soit suffisant pour des chantiers accusant parfois près d’une décennie de retard.
Il est désespérant de constater que, dix ans après leur lancement, les sept projets majeurs de pénétrantes autoroutières en Algérie ne sont pas encore terminés. Les retards, les problèmes techniques, les défaillances dans la préparation et la gestion des projets ont créé un véritable malaise économique et social dans les zones concernées. Il est urgent que les autorités prennent des mesures concrètes pour rectifier la situation et donner aux régions les infrastructures dont elles ont besoin pour se développer. Les Algériens attendent avec impatience la fin de ces travaux, qui devraient leur permettre de voyager en toute sécurité et de promouvoir l’économie locale. Seul l’avenir dira si les leçons tirées de ces expériences permettront de mieux gérer les futurs projets d’infrastructures en Algérie.
[ad_2]