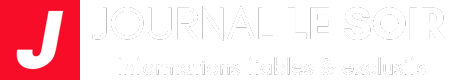[ad_1]
La nouvelle allocation touristique algérienne : un casse-tête économique et social
Depuis le début de l’année, une question agite la société algérienne : celle de l’allocation touristique de 750 euros, accessible une fois par an aux citoyens voyageant à l’étranger. Ce dispositif, qui permet d’acheter des devises au taux officiel, suscite autant d’espoirs que de polémiques. Pourtant, sa mise en œuvre tarde, révélant les tensions économiques et les dilemmes politiques qui traversent le pays.
La mesure, bien que symboliquement importante, ne représente qu’une infime partie des réserves de la Banque d’Algérie. Alors pourquoi tant d’hésitations ? Selon un expert économique, la réponse réside dans une maxime bien connue : « Chez nous, on légifère en pensant d’abord aux bandits. » En d’autres termes, les autorités redoutent les fraudes massives. Entre ceux qui envisagent de bénéficier plusieurs fois de l’allocation et ceux qui contournent les règles pour en profiter sans quitter le territoire, les risques sont réels.
Cette crainte a donné naissance à une idée pour le moins originale : un concours national visant à trouver le meilleur « filtre à bandits » pour encadrer cette allocation. Une proposition qui, bien qu’anecdotique, met en lumière les défis auxquels fait face l’administration. Celle-ci craint en effet un effet d’aubaine. Avec un écart important entre le taux officiel et celui du marché noir, chaque euro acheté au taux officiel permet de réaliser un gain substantiel.
Prenons un exemple concret : une famille nombreuse pourrait tirer profit de cette allocation pour financer un court séjour en Tunisie. En jouant sur les différences de change, elle pourrait économiser jusqu’à 86 250 dinars. Une somme non négligeable qui pourrait inciter davantage de ménages à voyager, même sans en avoir initialement l’intention.
Pourtant, les autorités semblent naviguer à vue. Aucune étude sérieuse n’a été menée pour évaluer l’impact de cette mesure sur le comportement des ménages. La raison ? Une réticence à mesurer l’ampleur de l’écart croissant entre le dinar officiel et le dinar parallèle, un écart qui atteint aujourd’hui 83 %. Ce fossé nourrit une économie souterraine, sape les efforts de développement et complique la gestion des politiques publiques, comme en témoigne le cas de l’allocation touristique.
Face à cette situation, des pistes de solution ont été esquissées. L’une d’elles consiste à taxer le premier voyage de l’année, une mesure qui reviendrait à introduire un taux de change spécifique pour cette allocation. Ce taux se situerait entre le cours officiel et celui du marché noir, réduisant ainsi l’effet d’aubaine. Mais cette idée, bien que pragmatique, ne fait pas l’unanimité.
Historiquement, le système d’allocation touristique a connu des hauts et des bas. Avant le contre-choc pétrolier des années 1980, de nombreux Algériens renonçaient à cette allocation, jugée trop contraignante pour les avantages qu’elle offrait. À l’époque, le dinar était encore fort et l’écart avec le marché noir limité. Aujourd’hui, la donne a changé.
Le maintien artificiel d’un dinar fort pour contenir l’inflation importée a des conséquences profondes. Il pénalise les exportations, favorise les importations et accentue le fossé avec le marché parallèle. Ce choix politique, bien que légitime, complique la gestion des devises et alimente les comportements frauduleux.
Dans ce contexte, l’allocation touristique apparaît comme un symbole des contradictions algériennes. D’un côté, elle répond à une aspiration légitime des citoyens à voyager et à accéder à des devises rares. De l’autre, elle met en lumière les dysfonctionnements d’un système économique sous pression.
Alors que les autorités cherchent un équilibre entre ouverture et contrôle, une question demeure : comment concilier les aspirations des citoyens avec les réalités économiques du pays ? La réponse à cette question déterminera non seulement le succès de cette allocation, mais aussi la capacité de l’Algérie à relever les défis économiques qui l’attendent.
[ad_2]